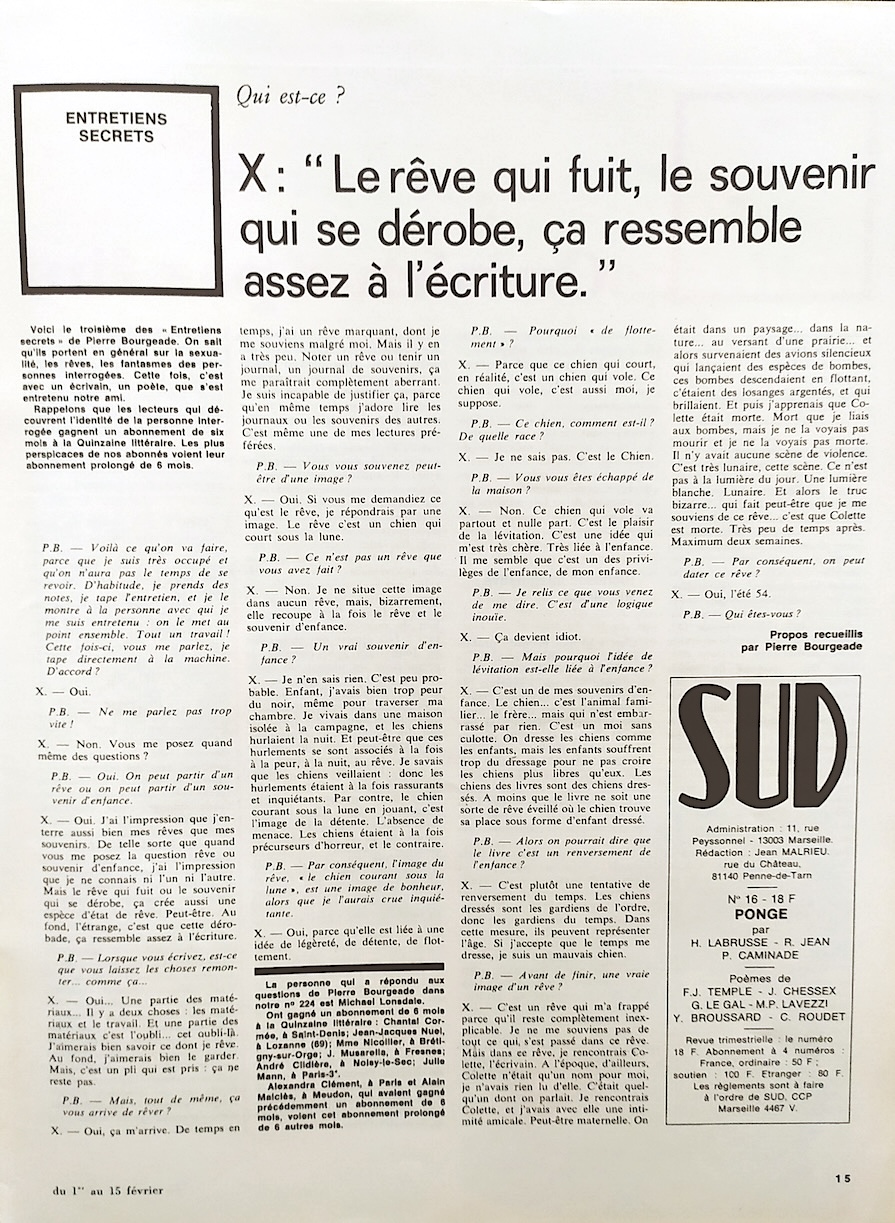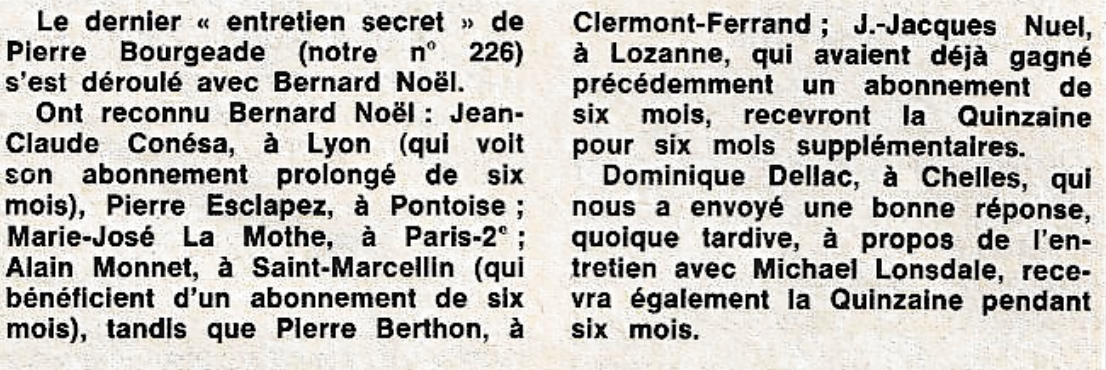Les « entretiens secrets » de la Quinzaine littéraire
Pierre Bourgeade mena plusieurs « entretiens secrets » pour la Quinzaine littéraire. Le journal les introduisait ainsi : « Ces entretiens présentent une certaine originalité : on ne saura pas qui parle. Nous avons en effet pensé que les entretiens, tels qu’ils se pratiquent d’ordinaire, où, dès le premier mot, la personne qui parle est nommée, laissent peu de place à la surprise. Dès qu’on a lu, par exemple : “Voici une interview de M. Jean-Paul Sartre ou de M. François Mauriac”, on sait à peu près ce qu’on va lire. D’où l’idée d’interroger des écrivains célèbres dont le nom, pour une fois, ne serait pas révélé. Cette première idée en entraînait une autre : l’obligation, pour l’écrivain interrogé, de ne parler ni de sa vie, ni de son œuvre, ce qui serait une autre façon de se nommer. Les Entretiens de la Quinzaine entraîneront les écrivains qui auront bien voulu s’y prêter à parler seulement de ce qui est en eux caché, secret, imaginaire. Autant dire : de ce qu’ils n’ont jamais écrit, de ce qu’ils n’ont jamais vécu. On voit que l’espace est grand ! » (n° 64, 01/01/1969)
Le premier entretien fut d’ailleurs consacré à… François Mauriac !
Un jeu était proposé aux lecteurs : « La Quinzaine Littéraire publiera un de ces entretiens chaque mois. Le mois suivant, le nom de l’écrivain interrogé sera révélé, en même temps que paraîtra un nouvel entretien. Dans ce délai d’un mois, nous vous invitons à nous écrire pour nous dire si vous avez reconnu l’interrogé, et à quels signes. Les meilleures réponses seront publiées et leurs auteurs recevront un abonnement de 3 mois à la Quinzaine Littéraire, ou verront leur abonnement prolongé de 3 mois. Les lecteurs qui, à la fin de l’année, auront découvert tous les écrivains interrogés recevront un cadeau-surprise avec nos sincères compliments. Nous pensons en effet que ces parleurs masqués, quoiqu’extrêmement connus, ne seront pas tous faciles à reconnaître ! C’est donc qu’ils pouvaient être connus différemment. » Quelques noms célèbres figurent parmi la liste des lecteurs gagnants publiée dans le numéro 74 :
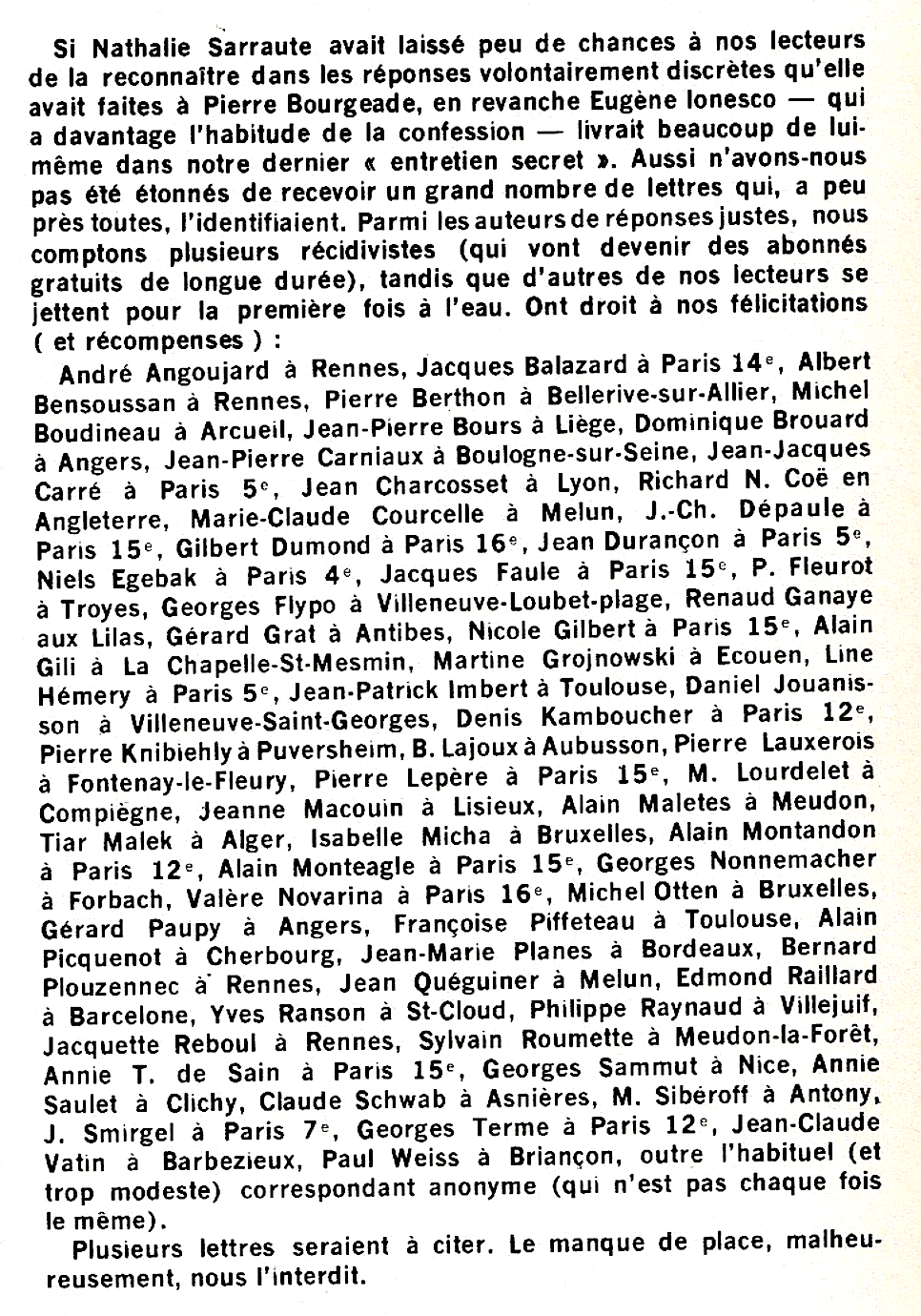
Il y eut deux séries d’entretiens : treize furent conduits de 1969 à 1970 [1] et cinq autres de 1975 à 1976 [2]. La plupart des personnalités interrogées étaient des écrivains mais quelques comédiens se prêtèrent également au jeu.
« Le rêve qui fuit, le souvenir qui se dérobe,
ça ressemble assez à l’écriture. »
C’est Bernard Noël qui se cachait derrière le « X » du numéro 226, paru le 1er février 1976 :
« Voici le troisième des “Entretiens secrets” de Pierre Bourgeade. On sait qu’ils portent en général sur la sexualité, les rêves, les fantasmes des personnes interrogées. Cette fois, c’est avec un écrivain, un poète, que s’est entretenu notre ami.
Rappelons que les lecteurs qui découvrent l’identité de la personne interrogée gagnent un abonnement de six mois à la Quinzaine littéraire. Les plus perspicaces de nos abonnés voient leur abonnement prolongé de 6 mois.
P.B. — Voilà ce qu’on va faire, parce que je suis très occupé et qu’on n’aura pas le temps de se revoir. D’habitude, je prends des notes, je tape l’entretien, et je le montre à la personne avec qui je me suis entretenu : on le met au point ensemble. Tout un travail ! Cette fois-ci, vous me parlez, je tape directement à la machine. D’accord ?
X. — Oui.
P.B. — Ne me parlez pas trop vite !
X. — Non. Vous me posez quand même des questions ?
P.B. — Oui. On peut partir d’un rêve ou on peut partir d’un souvenir d’enfance.
X. — Oui. J’ai l’impression que j’enterre aussi bien mes rêves que mes souvenirs. De telle sorte que quand vous me posez la question rêve ou souvenir d’enfance, j’ai l’impression que je ne connais ni l’un ni l’autre. Mais le rêve qui fuit ou le souvenir qui se dérobe, ça crée aussi une espèce d’état de rêve. Peut-être. Au fond, l’étrange, c’est que cette dérobade, ça ressemble assez à l’écriture.
P.B. — Lorsque vous écrivez, est-ce que vous laissez les choses remonter… comme ça…
X. — Oui… Une partie des matériaux… Il y a deux choses : les matériaux et le travail. Et une partie des matériaux c’est l’oubli… cet oubli-là. J’aimerais bien savoir ce dont je rêve. Au fond, j’aimerais bien le garder. Mais, c’est un pli qui est pris : ça ne reste pas.
P.B. — Mais, tout de même, ça vous arrive de rêver ?
X. — Oui, ça m’arrive. De temps en temps, j’ai un rêve marquant, dont je me souviens malgré moi. Mais il y en a très peu. Noter un rêve ou tenir un journal, un journal de souvenirs, ça me paraîtrait complètement aberrant. Je suis incapable de justifier ça, parce qu’en même temps j’adore lire les journaux ou les souvenirs des autres. C’est même une de mes lectures préférées.
P.B. — Vous vous souvenez peut-être d’une image ?
X. — Oui. Si vous me demandiez ce qu’est le rêve, je répondrais par une image. Le rêve c’est un chien qui court sous la lune.
P.B. — Ce n’est pas un rêve que vous avez fait ?
X. — Non. Je ne situe cette image dans aucun rêve, mais, bizarrement, elle recoupe à la fois le rêve et le souvenir d’enfance.
P.B. — Un vrai souvenir d’enfance ?
X. — Je n’en sais rien. C’est peu probable. Enfant, j’avais bien trop peur du noir, même pour traverser ma chambre. Je vivais dans une maison isolée à la campagne, et les chiens hurlaient la nuit. Et peut-être que ces hurlements se sont associés à la fois à la peur, à la nuit, au rêve. Je savais que les chiens veillaient, donc les hurlements étaient à la fois rassurants et inquiétants. Par contre le chien courant sous la lune en jouant, c’est l’image de la détente. L’absence de menace. Les chiens étaient à la fois précurseurs d’horreur, et le contraire.
P.B. — Par conséquent, l’image du rêve, “le chien courant sous la lune”, est une image de bonheur, alors que je l’aurais crue inquiétante.
X. — Oui, parce qu’elle est liée à une idée de légèreté, de détente, de flottement.
P.B. — Pourquoi “de flottement” ?
X. — Parce que ce chien qui court, en réalité, c’est un chien qui vole. Ce chien qui vole, c’est aussi moi, je suppose.
P.B. — Ce chien, comment est-il ? De quelle race ?
X. — Je ne sais pas. C’est le Chien.
P.B. — Vous vous êtes échappé de la maison ?
X. — Non. Ce chien qui vole va partout et nulle part. C’est le plaisir de la lévitation. C’est une idée qui m’est très chère. Très liée à l’enfance. Il me semble que c’est un des privilèges de l’enfance, de mon enfance.
P.B. — Je relis ce que vous venez de me dire. C’est d’une logique inouïe.
X. — Ça devient idiot.
P.B. — Mais pourquoi l’idée de lévitation est-elle liée à l’enfance ?
X. — C’est un de mes souvenirs d’enfance. Le chien… c’est l’animal familier… le frère… mais qui n’est embarrassé par rien [3]. C’est un moi sans culotte. On dresse les chiens comme les enfants, mais les enfants souffrent trop du dressage pour ne pas croire les chiens plus libres qu’eux. Les chiens des livres sont des chiens dressés. À moins que le livre ne soit une sorte de rêve éveillé où le chien trouve sa place sous forme d’enfant dressé.
P.B. —- Alors on pourrait dire que le livre c’est un renversement de l’enfance ?
X. — C’est plutôt une tentative de renversement du temps. Les chiens dressés sont les gardiens de l’ordre, donc les gardiens du temps. Dans cette mesure, ils peuvent représenter l’âge. Si j’accepte que le temps me dresse, je suis un mauvais chien.
P.B. — Avant de finir, une vraie image d’un rêve ?
X. — C’est un rêve qui m’a frappé parce qu’il reste complètement inexplicable. Je ne me souviens pas de tout ce qui s’est passé dans ce rêve. Mais dans ce rêve, je rencontrais Colette, l’écrivain. À l’époque, d’ailleurs, Colette n’était qu’un nom pour moi, je n’avais rien lu d’elle. C’était quelqu’un dont on parlait. Je rencontrais Colette, et j’avais avec elle une intimité amicale. Peut-être maternelle. On était dans un paysage… dans la nature… au versant d’une prairie… et alors survenaient des avions silencieux qui lançaient des espèces de bombes ; ces bombes descendaient en flottant, c’étaient des losanges argentés, et qui brillaient. Et puis j’apprenais que Colette était morte. Mort que je liais aux bombes, mais je ne la voyais pas mourir et je ne la voyais pas morte. Il n’y avait aucune scène de violence. C’est très lunaire, cette scène. Ce n’est pas à la lumière du jour. Une lumière blanche. Lunaire. Et alors le truc bizarre… qui fait peut-être que je me souviens de ce rêve… c’est que Colette est morte. Très peu de temps après. Maximum deux semaines.
P.B. — Par conséquent, on peut dater ce rêve ?
X. — Oui, l’été 54.
P.B.-— Qui êtes-vous ?”
[1] Avec François Mauriac (n° 64), André Pieyre de Mandiargues (n° 66), J. M. G. Le Clézio (n° 68), Nathalie Sarraute (n° 70), Eugène Ionesco (n° 72), Pierre Klossowski (n° 74), Raymond Queneau (n° 76), Marguerite Duras (n° 80), Claude Roy (n° 82), Joyce Mansour (n° 84), Georges Perec (n° 88), Jacques Borel (n° 90) et Michel Butor (n° 92). Pierre Bourgeade les a rassemblés dans son livre Violoncelle qui résiste (éd. Éric Losfeld, 1971).
[2] Jeanne Moreau (n° 222), Michael Lonsdale (n° 224), Bernard Noël (n° 226), Emmanuelle Riva (n° 228) et Rita Renoir (n° 230).
[3] Le chien Rip compta beaucoup dans l’enfance de Bernard Noël (voir notre article Le pays d’enfance).
(©Pierre Bourgeade & Bernard Noël, la Quinzaine littéraire n° 226, 01/02/1976)
https://www.maurice-nadeau.
Nous remercions Gilles Nadeau d’avoir autorisé la mise en ligne de cet « entretien secret ».
Solution
La solution fut donnée dans le n° 228 ainsi que la liste des gagnants :